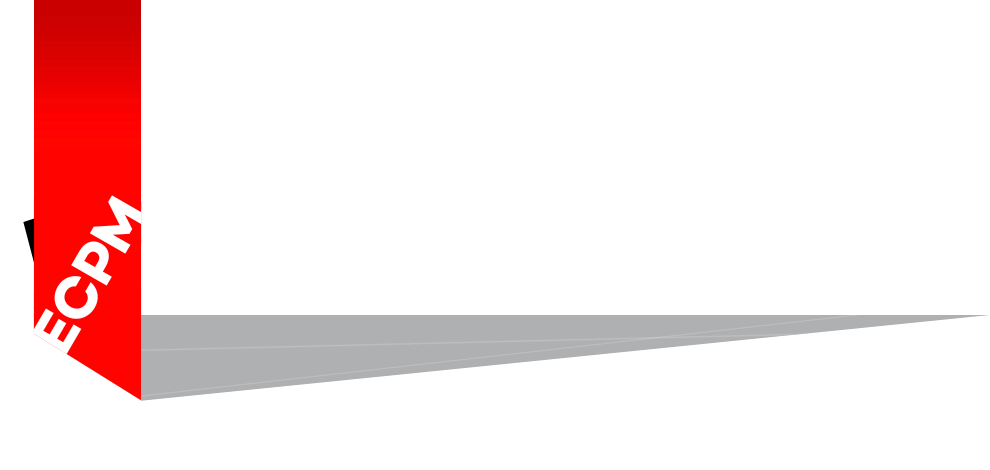Camus / Koestler : réflexions sur la peine de mort
21 novembre 2013
Albert Camus et Arthur Koestler : « Il n’est pas prouvé que la peine de mort ait fait reculer un seul meurtrier, décidé à l’être, alors qu’il est évident qu’elle n’a eu aucun effet, sinon de fascination, sur des milliers de criminels ».
En Europe, le mouvement abolitionniste renaît de ses cendres dans l’après Seconde Guerre mondiale. Jean Genet (1910-1986) écrit dès 1942 un magnifique plaidoyer qu’il nomme d’ailleurs « Le Condamné à mort ». Mais c’est avec la publication en 1957 d’un ouvrage très médiatique que le combat contre la sanction capitale trouve un nouveau souffle. Il est l’œuvre de deux hommes, l’un Français, l’autre Hongrois : Albert Camus (1913-1960) et Arthur Koestler (1905-1983). « Réflexions sur la peine capitale » est le recueil de « Réflexions sur la potence » (Reflexions on Hanging) de Koestler et de « Réflexions sur la guillotine » de Camus. Le premier de ces deux écrits porte sur le Royaume-Uni : « La Grande-Bretagne est ce curieux pays d’Europe […] où l’on pend les gens par le cou jusqu’à ce que mort s’ensuive ». Il s’agit d’une étude historique, psychologique, juridique, qui constitue une réfutation point par point de tous les arguments en faveur de la potence. Les exemples des défauts du « Code sanglant », surnom du Code pénal anglais, sont innombrables. Basé sur la « Common Law », la loi commune, il ne fonctionne qu’au titre de la jurisprudence. Par voie de conséquence, tout nouveau crime auquel un juge applique la peine capitale, durcit le Code sanglant d’un nouveau délit passible de mort. C’est ainsi que des enfants de moins de 10 ans se retrouvent pendus pour des larcins de pacotilles… Et que plus de 350 crimes sont alors punissables de la pendaison : « tels que le vol de navets, le fait de s’associer avec des gitans, les dommages causés aux poissons des étangs, l’envoi de lettres de menaces, ou le fait d’être trouvé armé ou déguisé dans une forêt. »
Dans son étude, Arthur Koestler développe une idée neuve pour le mouvement abolitionniste. Même les plus convaincus par la barbarie et l’iniquité de la sanction capitale : « ne sont pas à l’abri d’occasionnelles impulsions vindicatives [Cela] ne signifie pas que de telles impulsions doivent être sanctionnées par la loi, pas plus que ne sont sanctionnés les autres instincts coupables qui font partie de notre hérédité biologique. Au fond de chaque homme civilisé se tapit un petit homme de l’âge de pierre, prêt au vol et au viol, et qui réclame à grands cris un œil pour un œil. Mais il vaudrait mieux que ce ne fût pas ce petit personnage habillé des peaux de bêtes qui inspirât la loi de notre pays. » L’instinct est combattu par la civilisation, afin, si ce n’est de nous rendre meilleurs, en tout cas que la société le soit. Cette dernière ne peut être l’addition de tous les réflexes primaires de l’être humain. Elle doit au contraire les réprimer par des lois justes et humaines. Arthur Koestler déduit de son étude que : « Les défauts de la loi sur la peine de mort sont irrémédiables, parce que la peine de mort se fonde sur une conception philosophique de la responsabilité qui ne souffre de compromis avec aucun des points de vue déterministes admis dans les autres tribunaux. En ce qui concerne les autres délits ou crimes, l’administration de la loi est souple : la peine de mort exclut, par sa nature même, toute possibilité de proportionner le châtiment à la responsabilité. Cette rigidité et l’intention dont elle procède, qui sont l’essence de la peine capitale, sont en même temps les sources de son attrait et de sa valeur symbolique pour toutes les forces anti progressistes de la société. » Être rétentionniste pour Koestler, c’est être rétrograde, c’est tourner le dos à la Civilisation. Celle-ci est synonyme de progrès et s’oppose dans sa définition au terme de barbarie. Ce que nous dit Koestler, finalement, c’est que la civilisation occidentale peut produire les formes les plus cruelles de barbarie, et qu’il est indispensable de faire preuve de la plus grande modestie quant au degré de civilisation atteint par notre société.
Le second texte, celui d’Albert Camus, se fonde lui aussi sur les effets délétères de la peine de mort pour la société. Déjà dans « L’Étranger »(1942), Camus stigmatise la peine de mort, ainsi que dans « La Peste » (1947), où l’auteur relate la saisissante scène d’une exécution capitale par fusillade qui a obsédé le jeune Tarou. « Réflexions sur la guillotine » n’est que la synthèse théorisant l’ensemble de sa pensée essayiste et philosophique. Albert Camus évoque tout d’abord un douloureux souvenir d’enfance : son père est très en colère contre un criminel condamné à mort pour le meurtre d’une famille entière. Le jour de l’exécution, le père de Camus part de la maison, plein d’enthousiasme, au petit matin, pour assister à l’événement : « Ce qu’il vit ce matin-là il n’en dit rien à personne. Ma mère raconte seulement qu’il rentra en coup de vent, le visage bouleversé, refusa de parler, s’étendit un moment sur le lit et se mit tout d’un coup à vomir. » L’horreur de la scène a révulsé le voyeur : « Au lieu de penser aux enfants massacrés, il ne pouvait plus penser qu’à ce corps pantelant qu’on venait de jeter sur une planche pour lui couper le cou. »
Le pourfendeur de la peine capitale se livre à une déduction : « Il faut croire que cet acte rituel est bien horrible pour arriver à vaincre l’indignation d’un homme simple et droit pour qu’un châtiment qu’il estimait cent fois mérité n’ai eu finalement d’autre effet que de lui retourner le cœur. » Il en conclut que : « quand la suprême justice donne seulement à vomir à l’honnête homme qu’elle est censée protéger il paraît difficile de soutenir qu’elle est destinée, comme ce devrait être sa fonction, à apporter plus de paix et d’ordre dans la cité. Il éclate au contraire qu’elle n’est pas moins révoltante que le crime et que ce nouveau meurtre, loin de réparer l’offense faite au corps social, ajoute une nouvelle souillure à la première. » L’impossible justification de la peine de mort est donc la thèse que soutient Albert Camus. Pour cela il démonte l’argumentaire des partisans de la peine de mort. Pour ces derniers l’argument ultime est celui de l’exemplarité de la peine. Camus rétorque sur trois points distincts : « la société ne croit pas elle-même à l’exemplarité dont elle parle ; il n’est pas prouvé que la peine de mort ait fait reculer un seul meurtrier, décidé à l’être, alors qu’il est évident qu’elle n’a eu aucun effet, sinon de fascination, sur des milliers de criminels ; elle constitue, à d’autres égards, un exemple repoussant dont les conséquences sont imprévisibles. » Ainsi, pour notre auteur, le fait de cacher dans l’enceinte des prisons les exécutions à partir de 1939, prouve que la société ne veut pas montrer l’exemple – au combien mauvais – qu’elle donne : « Comment l’assassinat furtif qu’on commet la nuit dans une cour de prison peut-il être exemplaire ? […] pour qu’une peine soit vraiment exemplaire, il faut qu’elle soit effrayante. Tuaut de la Bouverie, représentant du peuple en 1791, et partisan des exécutions publiques, était plus logique lorsqu’il déclarait à l’Assemblée nationale "Il faut un spectacle terrible pour contenir le peuple."» Par voie de conséquence, l’État camouflant les exécutions ne croit pas en la valeur exemplaire de la peine capitale, sinon par tradition puisqu’il utilise les mêmes procédés techniques depuis la fin du XVIIIe siècle. La guillotine d’ailleurs est vilipendée par Albert Camus. Il appuie ses dires par des avis d’experts, notamment les docteurs Piedelièvre et Fournier : « Si nous pouvons nous permettre de donner notre avis à ce sujet, de tels spectacles sont affreusement pénibles [s’ensuit une description médicale et morbide à peine soutenable] Il ne reste, pour le médecin, que cette impression d’une horrible expérience, d’une vivisection meurtrière, suivies d’un enterrement prématuré. » Mais surtout, ce qui est le plus grave pour l’auteur, c’est que, reprenant les paroles de Gambetta : « Si vous supprimez l’horreur du spectacle, si vous exécutez dans l’intérieur des prisons, vous étoufferez le sursaut public de révolte qui s’est manifesté ces dernières années et vous allez consolider la peine de mort. » En cachant la honte, celle-ci devient ordinaire et plus personne n’en fait cas puisque l’on ne voit plus l’atrocité du supplice.
En second lieu les rétentionnistes arguent que, soit, rien ne prouve l’exemplarité de la peine et qu’il est même certain que des milliers de meurtriers n’ont pas été intimidés par l’échafaud. Toutefois, ne pouvant connaître ceux qui auraient pu être arrêtés dans leur geste par la peur de la peine, rien ne prouve qu’elle ne soit pas non plus exemplaire. Or, est-il concevable d’envoyer à la guillotine un nombre d’hommes et de femmes incalculable sur une idée (« la peine de mort est exemplaire ») reposant sur une hypothèse invérifiable : « Si la peur de la mort, en effet, est une évidence, c’en est une autre que cette peur, si grande qu’elle soit, n’a jamais suffi à décourager les passions […] Ainsi, le plus grand des châtiments, celui qui entraîne la déchéance dernière pour le condamné, et qui octroie le privilège suprême à la société, ne repose sur rien d’autre que sur une possibilité invérifiable. »
Enfin, l’exemple de la loi est dangereux et malsain pour la société : « On peut déjà suivre les effets exemplaires de ces cérémonies dans l’opinion publique, les manifestations de sadisme qu’elles y réveillent, l’affreuse gloriole qu’elles suscitent […] Aucune noblesse autour de l’échafaud, mais le dégoût, le mépris ou la plus basse des jouissances […] Écoutons […] ce chapelain qui parle d’horreur, de honte et d’humiliation. »
Cependant, Camus apporte une seule et infime nuance à son argumentaire : « Personne ne peut contester l’existence de certains fauves sociaux, dont rien ne semble capable de briser l’énergie et la brutalité. La peine de mort, certes ne résout pas le problème qu’ils posent. Convenons du moins qu’elle le supprime…] Leurs crimes sont certains […] Il faut seulement éviter qu’ils recommencent et il n’y a pas d’autre solution que les éliminer. Sur cette frontière et sur elle seule, la discussion autour de la peine de mort est légitime » Or, bien que le philosophe accepte de parler de ce cas-là, il le règle personnellement avec sa conscience et sa morale propre. Et surtout il évolue au fil du temps. Ainsi, François Mauriac à la Libération demande la charité pour les collaborateurs. Camus lui répond à travers le journal « Combat », qu’il veut la justice avant la charité. Toutefois il se rétracte, reconnait publiquement que Mauriac a raison et à l’instar de Marcel Aymé, Albert Camus demande la grâce de Robert Brasillach, au-delà du mépris et de la haine qu’il éprouve pour lui : « Un mouvement plus fort que toute justice m’oblige maintenant à souhaiter qu’on épargne ces condamnés (les collaborateurs) et qu’on leur rende seulement cette vie que dans leur folie ils ont assez méprisée pour en faire bon marché quand il s’agissait des autres. »
Marie Gloris Bardiaux-Vaïente,
Doctorante attachée au CEMMC, doctorante associée au CIRAP