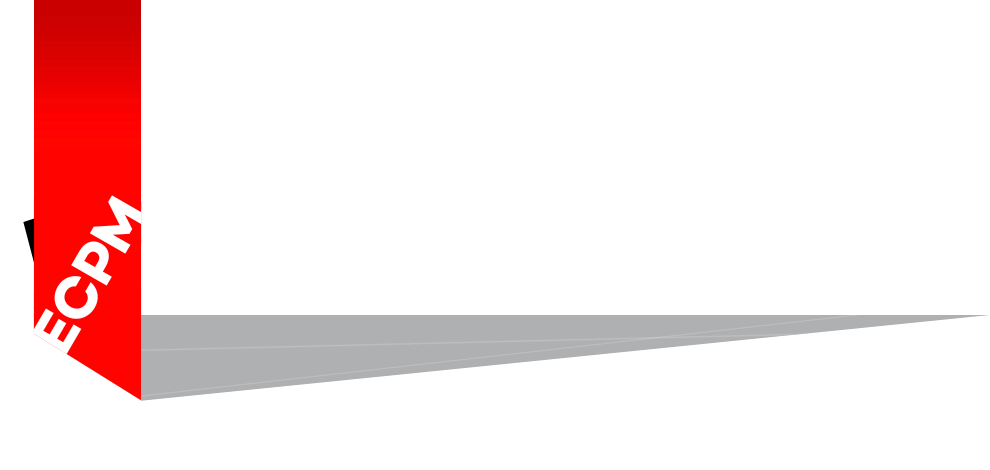Peine de mort et droit à la vie
19 avril 2009
Actuellement tous les pays de l’Union européenne ont aboli la peine de mort, en vertu du principe selon lequel toute vie humaine, même celle d’un assassin, doit être respectée. Or il est parfois nécessaire d’imposer des limites au droit à la vie lorsqu’il entre en contradiction avec d’autres droits fondamentaux tels que la liberté individuelle. C’est le cas notamment pour l’euthanasie, le suicide assisté ou l’avortement.
Le droit à la vie est reconnu par la communauté internationale comme étant le plus fondamental de tous les droits humains. Préalable nécessaire à l’exercice de tous les autres droits, il doit rester inaliénable. Ce droit justifie pleinement l’abolition de la peine de mort, acte de barbarie et de vengeance, donnant à la justice un caractère meurtrier, soumis aux aléas de la passion, alors que la justice a pour vocation de régir des rapports sociaux sains et paisibles et non d’attiser la violence en répondant à « l’horreur par l’horreur ».
Que devrait faire la famille du condamné, exécuté et donc, à ses yeux, assassiné par la justice, alors même que cette justice est censée protéger les droits humains et au premier rang, le droit à la vie ? Qu’en est-il si cette personne était innocente, si le véritable meurtrier est retrouvé par la suite ou, pire encore, comme cela s’est déjà produit, si la « victime » est en fait vivante ? Comment réparer un tel « préjudice » ? Comment peut-on demander à un citoyen de faire confiance à une justice qui peut commettre de telles erreurs… Des erreurs mortelles.
Consentement à sa propre mort
Cet argument est parfois transposé au corps médical : les adversaires de l’euthanasie ou du suicide assisté invoquent souvent le risque de perte de confiance du patient envers son médecin, qui, dans certains cas, aurait le droit de mettre fin à la vie. Or ces problématiques sont sensiblement différentes. En effet, dans les cas les plus fréquents, de malades incurables, en fin de vie, demandant expressément, de façon claire et répétée, une aide pour mettre fin à leurs jours, la situation ne peut pas être comparée à celle d’un innocent se faisant exécuter, suite à un jugement, rendu par un tribunal qualifié.
La différence fondamentale repose sur le rôle du consentement de la personne à sa propre mort, consentement qui devra être donné dans des conditions permettant d’éviter tout abus. En effet, une fois ce consentement donné, de manière univoque et « sans appel », le problème qui se pose est de savoir dans quelle mesure l’obligation positive de l’État de protéger la vie de toute personne humaine doit se limiter au regard de la liberté individuelle, du droit à l’auto-détermination et de la dignité humaine. Devrait-on imposer à l’État de protéger la vie absolument, même à l’encontre de la volonté expresse de la personne dont la vie est en jeu ? Même si cette vie est devenue insupportable et ce, de manière irrémédiable ? Même si le fait de privilégier la valeur quantitative au détriment de la valeur qualitative de la vie revient à obliger la personne à supporter des « souffrances insupportables » et donc, à se trouver dans une situation qui porte atteinte à sa dignité ?
La dignité humaine est au fondement de toute société démocratique. Proclamée dans la DUDH de 1948 et consacrée par la Charte des droits fondamentaux, de juin 2000, elle n’obtiendra une valeur juridique contraignante qu’avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Signé en 2007 par les 27 État membres de l'Union, le texte renforce les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée : « L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme (…) ».
Son entrée en vigueur, initialement prévue en janvier 2009, reste toujours soumise à sa ratification par l’ensemble des États membres. Les Tchèques ne l'ont pas encore ratifié et les Irlandais l'ont repoussé une première fois par référendum, en 2008.
Hélène Labbouz