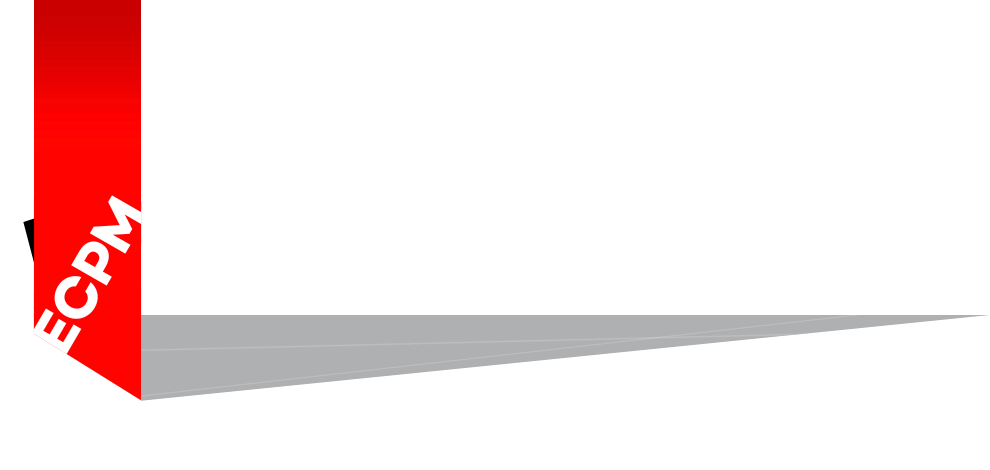Cahiers de l’abolition : Iran, la peine de mort en question
9 octobre 2014
Les Cahiers de l’abolition s’enrichissent d’un nouveau numéro consacré cette année à l’Iran. Dans une démarche plus scientifique que militante, une vingtaine de personnalités y ont apporté leur contribution afin de faire comprendre la réalité de la peine de mort dans la République islamique tant au niveau judiciaire, social que politique. Plus de détails avec Nordine Drici, coordinateur de cette dernière édition des Cahiers de l’abolition pour Ensemble contre la peine de mort (ECPM) et directeur des programmes du Pôle Actions à l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT).
Pourquoi consacrer les Cahiers de l’abolition 2014 au cas iranien ?
Depuis la révolution islamique de 1979 qui a mis fin à la dictature du shah, les autorités iraniennes utilisent de manière massive la peine de mort. L’Iran est le deuxième pays qui exécute le plus au monde et le premier en nombre d’exécutions par habitant. Il semblait important à ECPM de consacrer sa revue scientifique à cette réalité, d’autant que la République islamique d’Iran s’apprête à passer à la fin du mois l’Examen périodique universel, un mécanisme mis en place en 2006 par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies qui sert à examiner la situation des droits des l’homme dans un certain nombre de pays. C’est aussi pour ECPM une manière d’approfondir les rapports publiés chaque année sur la peine de mort en Iran en partenariat avec l’ONG Iran Human Rights.
Quelles sont vos ambitions pour cette édition des Cahiers de l’abolition ?
L’une des finalités est d’informer et d’alerter sur la réalité de la peine de mort en Iran. Il s’agit aussi de nourrir le débat et d’appuyer le travail des défenseurs des droits de l’homme à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iran en leur apportant des informations qu’ils n’auraient pas les moyen de collecter et qu’ils pourront exploiter pour construire leurs argumentaires. Ces cahiers de l’abolition peuvent aussi constituer un outil d’analyse pour la société civile et les diplomaties des pays abolitionnistes. Il y a un fort enjeu de lobbying auprès de la communauté internationale et des autorités iraniennes.
En juin 2013, la victoire d’Hassan Rohani à l’élection présidentielle d’Iran a fait naître beaucoup d’espoirs. Malheureusement, les exécutions qui ont eu lieu au cours des deux trimestres suivant son arrivée au pouvoir ont été deux fois plus nombreuses que dans les six mois précédents. Pourtant, le président iranien peut donner des directives aux gouverneurs locaux qui ont un réel pouvoir concernant l’application des exécutions. Le mouvement abolitionniste international doit inciter les autorités iraniennes à prendre des mesures pour limiter les exécutions.
Comment avez-vous choisi les thèmes et les auteurs ?
L’idée est d’offrir un panorama aussi large que possible de la réalité de la peine de mort en Iran et d’en donner une analyse détaillée et multidimensionnelle sur le plan judiciaire, social et politique. S’inscrivant dans une démarche plus scientifique que militante, cette revue cherche à croiser les regards d’acteurs variés. On a ainsi fait appel à une vingtaine de personnalités. Le plus souvent des figures emblématiques du combat pour les droits de l’homme, des juristes expérimentés ou d’éminents spécialistes sur le plan scientifique, tels que l’avocate Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix 2003, le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme en Iran, Ahmed Shaheed, l’avocate Nasrin Sotoudeh qui a reçu le prix Sakharov, ou encore le journaliste Emadeddin Baghi qui a obtenu le prix des droits de l’homme de la République française.
Comment la peine de mort a-t-elle évolué depuis l’instauration de la république islamique en 1979 ?
Le recours de la peine de mort était déjà répandu sous la dynastie des Qadjar de 1786 à 1925 puis sous les Pahlavi de 1925 à 1979. Mais jusque-là, d’après les écrits dont on dispose, les exécutions étaient très rarement publiques. C’est la véritable césure qu’opère en 1979 la révolution islamique dans la pratique de la peine de mort. En 2013, 10% des exécutions se sont tenues dans l’espace public, soit une soixantaine en tout. Elles sont censées jouer un rôle d’exemplarité et sont organisées comme de grands événements auxquels assiste un grand nombre d’Iraniens et notamment des enfants. Mais, attention : assister ne signifie pas adhérer. C’est tout la complexité du décryptage de ce phénomène.
La peine de mort s’est aussi largement généralisée et s’est désormais exercé au nom de sources religieuses souvent extra-législatives. Son application est devenue très arbitraire. Depuis 1979, on observe des pics liés à des événements politiques et au contexte social. A l’été 1988, par exemple, alors que la guerre contre l’Irak vient de s’acheveret que la rentrée universitaire s’annonce agitée, 45 000 à 50 000 prisonniers politiques sont exécutés. Depuis 2005, à l’exception de l’année 2012, les exécutions ne cessent d’augmenter. On en compte en moyenne entre 600 et 700 par an selon notre partenaire Iran Human Rights. En cette année 2014, il y a déjà eu 411 exécutions. La pratique des exécutions secrètes tend aussi à se développer. On les estime à plus d’une centaine par an. On ne connaît alors ni l’identité des personnes exécutées ni les motifs d’accusation.
Dans les couloirs de la mort, quels sont les droits légaux des condamnés ? Quels liens peuvent-ils avoir avec leur avocat et leur famille ?
Les droits légaux des condamnés à mort sont extrêmement restreints. il s’avère très difficile pour les avocats de défendre leurs clients. Ils peuvent eux-mêmes être envoyés en prison. Pour les familles, la situation est aussi très compliquée. Elles n’ont toujours la possibilité de rendre une dernière visite à leur proche et peuvent être informées de son exécution des mois plus tard.'
La peine de mort touche-t-elle davantage les minorités ?
En effet, les minorités, qu’elles soient ethniques, religieuses ou sexuelles, sont sur-représentées dans les couloirs de la mort. Les principaux chefs d’accusations utilisés contre les minorités sont la possession ou le trafic de drogues passibles de peine de mort, de « corruption sur terre (efsad fel-arz) ou encore le « moharebe » qui signifie littéralement « guerre contre Dieu » et qui désigne les crimes rejaillissant sur la société dans son ensemble, comme les actes de terrorisme ou les attaques armées contre des civils. Quant aux homosexuels, ils entrent dans la catégorie des « hodoud », ces peines obligatoires prévues, entre autres, en cas d’adultères, de viols et de relations sexuelles entre hommes.
Quelle est la situation des femmes face à la peine de mort ?
Entre 2008 et 2014, 79 femmes ont été exécutées, ce qui représente 2,4% des exécutions connues. C’est peu mais il y a une tendance à l’augmentation. Les femmes sont surtout condamnées pour des questions de drogue et de meurtre.
Elles sont victimes de discriminations graves. En cas de lapidation, par exemple, elles sont enterrées jusqu’au cou alors que l’homme ne l’est que jusqu’à la taille, ce qui lui donne plus de chance d’échapper aux pierres et d’être ainsi acquitté. Il y a aussi une inégalité au niveau de l’âge fixé pour la responsabilité pénale. Les filles le sont à 9 ans alors que les garçons le sont à 15 ans. Une fillette de 10 ans peut donc être jugée dans les mêmes conditions qu’une femme de 40 ans.
En revanche, les mères et les épouses peuvent jouer un rôle décisif dans le mécanisme du pardon qui peut aboutir à la libération du condamné si une contribution financière, appelée le « prix du sang » (diyeh), est versée.
Les exécutions de mineurs sont-elles une pratique courante ?
Il y aurait plus de 160 délinquants mineurs dans les couloirs de la mort. Le plus souvent, quand un mineur est condamné à la peine de capitale, il est détenu jusqu’à ses 18 ans pour être exécuté. C’est clairement une double peine qui est appliquée aux enfants.
L’Iran a adhéré dès 1994 à la Convention internationale des droits de l’enfant mais en imposant une réserve de taille : respecter uniquement les dispositions qui ne vont pas à l’encontre de ses lois nationales et du droit islamique. Selon le nouveau code pénal iranien, adopté en 2013, un mineur est un individu qui n’a pas encore atteint l’âge de la maturité. Or, il n’existe pas de définition objective de la maturité en droit islamique. Mais ce « flou » juridique offre une solution de contournement dans l’application de la peine de mort pour les mineurs car il est désormais possible pour un juge qui souhaite déterminer la maturité d’un enfant de faire appel à un médecin légiste qui peut alors déclarer une maturité insuffisante et protéger l’enfant de la condamnation à mort. Mais pour l’instant, le recours aux médecins légistes n’est pas une pratique répandue.
Comment le mouvement abolitionniste est-il porté à l’intérieur de l’Iran ?
C’est difficile de parler d’une dynamique structurée et organisée pour des raisons très compréhensibles. Il y a eu un véritable affaiblissement de la société iranienne suite aux protestations contre la réélection du président Mahmoud Ahmadinejad en 2009. D’importantes vagues d’arrestations ont frappé les défenseurs des droits de l’homme et de nombreuses associations ont dû mettre un terme à leurs activités.
Néanmoins, il existe des initiatives. L’association Pour le Droit à la vie, fondée en 2005 par Emadeddin Baghi, oeuvre contre le développement de la violence dans la société iranienne et, dans ce cadre, cherche à réduire le nombre d’exécutions. Il y a aussi le groupe Legam constitué de personnalités politiques, artistiques et universitaires, qui veulent sensibiliser la société iranienne sur la peine de mort. Mais dans une société hyper surveillée et censurée où la liberté de la presse est quasi inexistante, les marges de manoeuvre restent très limitées.
Malgré tout, y a-t-il des moyens d’action pour faire avancer la cause abolitionniste dans ce pays ?
En Iran, les associations n’ont absolument pas les moyens de contrer les autorités sur cette question. Il faut d’abord les aider à s’organiser et à renforcer leur autonomisation pour qu’elles puissent réveiller l’activisme des citoyens iraniens et tenter de jouer un rôle de garde-de-fou contre le phénomène des exécutions. Il faut aussi investir les espaces de dialogues qui existent dans les cercles religieux et scientifiques. Enfin, il est indispensable de trouver la juste articulation entre les organisations nationales et internationales pour mener des opérations constructives. Parfois, une mobilisation internationale trop insistante ou déplacée peut agacer le pouvoir iranien et dès lors menacer le travail des activistes locaux.
Par ailleurs, au niveau diplomatique, des relais pourraient se créer. Je pense notamment à certains États d’Amérique du Sud avec lesquels l’Iran a de bonnes relations économiques et politiques, tels que le Brésil, le Venuezela, l’Argentine, l’Equateur et l’Uruguay. Ces pays peuvent parfois avoir plus de poids que l’Union européenne pour faire passer des recommandations, notamment lors des Examens périodiques universels.
Enfin, dans le cadre de la coopération internationale de lutte contre le trafic de stupéfiants, les États abolitionnistes pourraient conditionner leurs aides à l’abandon de la peine de mort pour les chefs d’accusation liés à la possession et au trafic de drogue. C’est d’ailleurs ce qu’a fait l’Irlande en 2011 puis le Danemark et le Royaume-Uni.
A titre personnel, qu’est-ce qui vous a le plus interloqué dans ces Cahiers de l’abolition ?
Propos recueillis par Camille Sarret.